Recherche
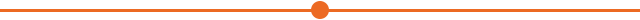
Editorial
Catherine SAUTÈS-FRIDMAN
Cher(e)s collègues,
C’est avec un grand plaisir que je vous présente ce numéro post-8es Journées Scientifiques Immunité et Cancer (JSIC 2024). Véritable succès (1 200 participants), elles confirment l’immense intérêt des oncologues pour cette manifestation annuelle riche en informations couvrant les multiples aspects de l’immuno-oncologie, depuis les traitements jusqu’aux nouveautés de la recherche académique. La lecture de la mise au point …
Cher(e)s collègues,
C’est avec un grand plaisir que je vous présente ce numéro post-8es Journées Scientifiques Immunité et Cancer (JSIC 2024). Véritable succès (1 200 participants), elles confirment l’immense intérêt des oncologues pour cette manifestation annuelle riche en informations couvrant les multiples aspects de l’immuno-oncologie, depuis les traitements jusqu’aux nouveautés de la recherche académique. La lecture de la mise au point (Boissel N, et al.) vous renseignera, spécialité par spécialité, sur les tops et les flops des résultats des essais thérapeutiques. Vous y lirez en particulier le succès des approches néoadjuvantes dans les tumeurs solides, des CAR T-cells et des anticorps bispécifiques en oncohématologie. À propos des nouveautés en recherche académique présentées lors des JSIC 2024, vous pourrez retrouver dans le précédent numéro un article sur les « cellules de l’année », les cellules B, qui furent très longtemps négligées au profit des lymphocytes T alors qu’elles produisent des anticorps, l’autre bras effecteur de l’immunité adaptative, à côté des cellules T cytotoxiques (Calvez A, et al.,
Rev Immun Cancer 2023 ; 7 : 164-74).
Mise au point
- anticorps bispécifiques
- CART-cells
- combinaisons
- hémopathies malignes
- immunothérapie
- inhibiteurs de checkpoint immunitaire
- tumeurs solides
Indications et place des immunothérapies dans la stratégie thérapeutique des cancers en 2023
Nicolas BOISSEL, Brigitte DRENO, Antoine F CARPENTIER, Jérôme FAYETTE, Laurent GREILLIER, Roch HOUOT, Marine GROSS-GOUPIL, Alexandra LEARY, Philippe MOREAU, Jean-Yves PIERGA, Julien TAIEB
Résumé:
Depuis quelques années, l’immunothérapie prend une place de plus en plus importante dans les stratégies thérapeutiques en oncologie et en oncohématologie. Elle se positionne aujourd’hui comme un standard de traitement dans les cancers digestifs, gynécologiques, du sein, cutanés, de la sphère ORL, thoraciques, génito-urinaires, ainsi que dans certaines hémopathies malignes …
Depuis quelques années, l’immunothérapie prend une place de plus en plus importante dans les stratégies thérapeutiques en oncologie et en oncohématologie. Elle se positionne aujourd’hui comme un standard de traitement dans les cancers digestifs, gynécologiques, du sein, cutanés, de la sphère ORL, thoraciques, génito-urinaires, ainsi que dans certaines hémopathies malignes. À travers les actualités de cette année, la révolution de l’immunothérapie en oncologie solide persiste et signe, avec une remontée des lignes dans plusieurs algorithmes de traitement, qui remettent même en cause la chirurgie dans certaines situations. De même, dans les hémopathies malignes, les approches d’immunothérapie (CAR T-cells et les anticorps bispécifiques) confirment leur place aux stades avancés dans le lymphome et le myélome multiple et montrent des résultats positifs, plus ou moins matures, dans les lignes antérieures de traitement. En revanche, l’immunothérapie n’a pas encore trouvé sa place dans les cancers de l’ovaire ou les glioblastomes, avec pour ces derniers un avenir qui se dessine avec des approches vaccinales antigènes-spécifiques. Aujourd’hui, plusieurs essais sont en cours afin de sélectionner les patients qui bénéficieraient d’une meilleure prise en charge et d’enrichir l’arsenal thérapeutique de ces différentes tumeurs.
Dossier Thématique
- inhibiteurs de checkpoints immunitaires
- myosite immunoinduite
- syndromes neurologiques paranéoplasiques
- toxicités neurologiques immuno-induites
Toxicités neurologiques des inhibiteurs de checkpoints immunitaires
Bastien JOUBERT
Résumé:
Les inhibiteurs de checkpoints immunitaires s’accompagnent d’une toxicité neurologique grave dans moins de 5 % des cas. Il s’agit dans la plupart des cas de manifestations subaiguës survenant avant les 6 premiers mois de traitement. Si les myosites, les neuropathies périphériques, et les encéphalites prédominent, tout le névraxe peut être atteint, y compris …
Les inhibiteurs de checkpoints immunitaires s’accompagnent d’une toxicité neurologique grave dans moins de 5 % des cas. Il s’agit dans la plupart des cas de manifestations subaiguës survenant avant les 6 premiers mois de traitement. Si les myosites, les neuropathies périphériques, et les encéphalites prédominent, tout le névraxe peut être atteint, y compris les méninges, le tronc cérébral, la moelle spinale et la jonction neuromusculaire. Les myosites sont la neurotoxicité la plus fréquente et, malgré leur corticosensibilité, elles peuvent mettre en péril le pronostic vital en cas d’atteinte du myocarde (25 % des cas). Les neuropathies démyélinisantes immuno-induites présentent un tableau de pseudo-syndrome de Guillain-Barré qui répond
généralement favorablement aux corticoïdes et aux immunoglobulines intraveineuses. Les neurotoxicités centrales sont dominées par les encéphalites immuno-induites, de présentation et de gravité variable, dont un sous-groupe présente des caractéristiques similaires aux encéphalites paranéoplasiques, notamment par la fréquente positivité des anticorps antineuronaux et leur caractère fréquemment réfractaire aux traitements. Le diagnostic repose sur une présentation clinique, biologique et/ou radiologique évocatrice, une fenêtre temporelle compatible, éventuellement la mise en évidence d’auto-anticorps antineuronaux et l’exclusion des diagnostics différentiels. La prise en charge des neurotoxicités immuno-induites est mal codifiée, et doit être adaptée en fonction de la forme clinique et de la sévérité. Elle repose en premier lieu sur l’arrêt immédiat de l’immunothérapie et la mise en place d’une corticothérapie. Des immunosuppresseurs sont nécessaires dans les formes sévères ou cortico-résistantes. L’amélioration des connaissances sur les mécanismes immunologiques qui les sous-tendent est nécessaire pour pouvoir améliorer la prise en charge de ces toxicités.
Cas Clinique
- anticorps conjugués
- biomarqueurs théranostiques
- cancer du sein triple-négatif
- immunothérapie
- inhibiteur de PARP
Cancer du sein triple négatif métastatique : à propos d’un cas
Adeline MOREL, Djelila ALLOUACHE, George EMILE
Résumé:
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. Malgré de très importantes avancées réalisées dans la prise en charge de ce cancer ces dernières années, certaines formes restent difficiles à traiter. C’est le cas du cancer triple négatif, une forme agressive qui représente 15 % des cas de cancer du sein. L’arrivée de nouvelles thérapies telles que l’immunothérapie, les inhibiteurs de PARP, …
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent. Malgré de très importantes avancées réalisées dans la prise en charge de ce cancer ces dernières années, certaines formes restent difficiles à traiter. C’est le cas du cancer triple négatif, une forme agressive qui représente 15 % des cas de cancer du sein. L’arrivée de nouvelles thérapies telles que l’immunothérapie, les inhibiteurs de PARP, les anticorps conjugués permet une amélioration de la survie sans progression et de la survie globale. Nous rapportons ici le cas d’une patiente avec un cancer du sein métastatique triple négatif ayant pu bénéficier des traitements successifs d’immunothérapie, inhibiteur de PARP et anticorps conjugués.
Article Bref
Immunothérapie et cancer du sein au SABCS 2023 : la quête de biomarqueurs et d’associations optimales continue
Alison JOHNSON
Résumé:
JUSTIFICATIFS ET OBJECTIFS
La place de l’immunothérapie (IO) dans le cancer du sein triple négatif (CSTN) localisé et avancé ne fait plus débat depuis l’annonce des résultats des études Keynote-522 (1) et Keynote-355 (2). La première mettait en évidence une amélioration significative du taux de réponse complète pathologique (pCR) et de la survie sans événement (SSE) avec l’ajout …
JUSTIFICATIFS ET OBJECTIFS
La place de l’immunothérapie (IO) dans le cancer du sein triple négatif (CSTN) localisé et avancé ne fait plus débat depuis l’annonce des résultats des études Keynote-522 (1) et Keynote-355 (2). La première mettait en évidence une amélioration significative du taux de réponse complète pathologique (pCR) et de la survie sans événement (SSE) avec l’ajout de pembrolizumab pré et post-opératoire à une chimiothérapie néoadjuvante (CNA) dans les CSTN > T2 et/ou N+ quelle que soit l’expression de PD-L1. La Keynote-355 a montré, chez des patientes ayant un CSTN avancé avec score CPS > 10, une amélioration significative de la survie globale (SG) par l’ajout de pembrolizumab versus placebo, à une chimiothérapie de 1re ligne. Dans le cancer du sein luminal RH+/HER2- localisé à haut risque de récidive, les résultats de deux essais de phase III combinant une IO à de la CNA, la Keynote-756 et la CheckMate 7FL, présentés à l’ESMO en 2023, notaient une amélioration significative des taux de pCR avec l’ajout de l’IO, certes bien inférieurs à ceux des CSTN, sans données de survie matures disponibles pour l’instant. Pour toutes ces études, l’identification de potentiels biomarqueurs prédictifs se poursuit afin d’essayer d’identifier au mieux les patients susceptibles de bénéficier des traitements. Le choix optimal de la chimiothérapie et le timing idéal néoadjuvant et/ou adjuvant de l’IO restent également des questions en suspens. Sans se vouloir exhaustif, cet article a pour but de faire le point sur les principales études d’IO présentées lors du SABCS 2023 avec l’objectif d’ébaucher des réponses à ces questions.
