Archives
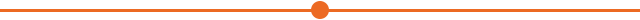
Editorial
Catherine SAUTÈS-FRIDMAN
Chers collègues,
Je suis émue de vous annoncer, comme indiqué dans le courriel de Dimitri Verza, Directeur de la publication, Président d’Olimpe, que ce numéro est le dernier de LA REVUE Immunité & Cancer, « la première − et restée l’unique − revue francophone trimestrielle dédiée à l’immuno-oncologie ». Solidement ancrés dans l’immuno-oncologie, bénéficiant de l’expertise et de l’enthousiasme …
Chers collègues,
Je suis émue de vous annoncer, comme indiqué dans le courriel de Dimitri Verza, Directeur de la publication, Président d’Olimpe, que ce numéro est le dernier de LA REVUE Immunité & Cancer, « la première − et restée l’unique − revue francophone trimestrielle dédiée à l’immuno-oncologie ». Solidement ancrés dans l’immuno-oncologie, bénéficiant de l’expertise et de l’enthousiasme des membres du comité scientifique et du comité éditorial, notre but a été de fournir un éclairage scientifique sur les avancées de l’immuno-oncologie à travers des dossiers thématiques et des articles de mise au point, d’informer sur l’actualité dans les « articles brefs » et la rubrique « OEil de l’interne », et enfin d’échanger sur le concret de l’immuno-oncologie grâce aux cas cliniques. Au cours de ces 9 années d’existence, nous avons fourni une information de qualité, couronnée par le Prix éditorial du Syndicat de la Presse et de l’Édition des Professions de Santé (SPEPS) pour trois de nos articles publiés en 2024 et 2025. Je remercie très sincèrement les nombreux rédacteurs d’avoir participé à cette aventure, portés par le sentiment d’être les acteurs du progrès de la médecine après des années de traversée du désert. Nous n’oublierons pas les moments intenses vécus lors des standing ovations des congrès de l’ASCO ou de l’ESMO ou de l’annonce de la remise du prix Nobel de médecine au Dr James Allison et au Professeur Tasuku Honjo pour « La découverte du traitement des cancers par inhibition de la régulation immunitaire négative ».
Avant-propos
Avant-propos
Dimitri VERZA
Résumé:
Chers tous,
Neuf ans après le lancement de LA REVUE Immunité & Cancer, communément appelée la RIC, et plus de 15 ans après l’introduction de l’immuno-oncologie dans la prise en charge des cancers, le groupe Kephren a souhaité engager une réflexion sur l’évolution de la ligne éditoriale de la revue. L’immuno-oncologie, révolution thérapeutique à part entière, est aujourd’hui pleinement intégrée dans la pratique …
Chers tous,
Neuf ans après le lancement de LA REVUE Immunité & Cancer, communément appelée la RIC, et plus de 15 ans après l’introduction de l’immuno-oncologie dans la prise en charge des cancers, le groupe Kephren a souhaité engager une réflexion sur l’évolution de la ligne éditoriale de la revue. L’immuno-oncologie, révolution thérapeutique à part entière, est aujourd’hui pleinement intégrée dans la pratique clinique et les stratégies de traitement de nombreuses pathologies. Les échanges d’expériences et les besoins en information, qui justifiaient la création de la 1re revue d’information pluridisciplinaire et crosspathologies, ont donc naturellement évolué. Par ailleurs, les attentes des professionnels de santé se sont transformées : ils recherchent désormais une approche plus globale, intégrant l’immunothérapie dans le continuum thérapeutique, aux côtés des thérapies ciblées, de la médecine de précision et des approches combinées. Dans ce contexte, le maintien d’une revue spécifiquement centrée uniquement sur l’immuno-oncologie ne répond plus que partiellement à ces nouvelles dynamiques de partage et de réflexion scientifique.
Mise au point
- anticorps conjugués (ADC)
- biomarqueurs prédictifs
- carcinome urothélial
- enfortumab vedotin – pembrolizumab
- immunothérapie (ICI)
Anticorps conjugués et immunothérapie dans le carcinome urothélial : de la synergie biologique aux implications cliniques
Safa ABDALLAHOUI, Fabien MOINARD-BUTOT, Philippe BARTHÉLÉMY
Résumé:
Les anticorps conjugués (ADC), en association aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI), ont profondément modifié la prise en charge du carcinome urothélial (CU). Ces associations reposent sur le rationnel biologique suivant : les ADC, au-delà de leur cytotoxicité dirigée contre la tumeur et son microenvironnement, induisent une mort cellulaire immunogène capable d’amorcer une réponse immune adaptative …
Les anticorps conjugués (ADC), en association aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire (ICI), ont profondément modifié la prise en charge du carcinome urothélial (CU). Ces associations reposent sur le rationnel biologique suivant : les ADC, au-delà de leur cytotoxicité dirigée contre la tumeur et son microenvironnement, induisent une mort cellulaire immunogène capable d’amorcer une réponse immune adaptative, tandis que les ICI en potentialisent la persistance et l’efficacité. L’association enfortumab vedotin (EV)-pembrolizumab a démontré en 1re ligne métastatique des CU des bénéfices cliniques majeurs, avec une survie globale médiane de 31,5 mois versus 16,1 mois sous chimiothérapie (HR 0,47) et un taux de réponse objective de 68 %, sans majoration notable de la toxicité. Ces résultats ont conduit à l’approbation de cette combinaison comme nouveau standard en première ligne métastatique et à son exploration en contexte péri-opératoire (EV-303/EV-304). D’autres ADC, tels que le sacituzumab govitecan et le datopotamab déruxtécan (ciblant Trop-2), le trastuzumab déruxtécan et le disitamab vedotin (ciblant HER2) associés à des ICI sont en cours d’évaluation, ouvrant la voie à une diversification des cibles thérapeutiques et des payloads (MMAE, inhibiteurs de topoisomérase I). Des questions persistent quant à la séquence optimale des traitements, aux résistances croisées entre ADC, aux choix des combinaisons et à la place des biomarqueurs (Nectin-4, Trop-2, HER2, PD-L1) pour guider la sélection des patients. Les combinaisons ADC-ICI redéfinissent désormais le paysage thérapeutique du CU et ouvrent la voie à des stratégies personnalisées, guidées par la biologie moléculaire.
Dossier Thématique
- ARNm
- combinaison thérapeutique
- néoantigènes
- vaccin thérapeutique anticancer
- vaccination adjuvante
Vaccin thérapeutique anticancer : état des lieux et avancées
Caroline LAHEURTE, Guillaume EBERST, Olivier ADOTEVI
Résumé:
Les vaccins thérapeutiques contre le cancer visent à activer et multiplier les lymphocytes T spécifiques d’antigènes de tumeurs afin d’éliminer de manière ciblée les cellules cancéreuses. Les récents progrès dans la découverte des néoantigènes issus de mutations génomiques des cellules tumorales et l’ingénierie des plateformes vaccinales, notamment les ARN messagers, ont redynamisé …
Les vaccins thérapeutiques contre le cancer visent à activer et multiplier les lymphocytes T spécifiques d’antigènes de tumeurs afin d’éliminer de manière ciblée les cellules cancéreuses. Les récents progrès dans la découverte des néoantigènes issus de mutations génomiques des cellules tumorales et l’ingénierie des plateformes vaccinales, notamment les ARN messagers, ont redynamisé le développement clinique des vaccins en cancérologie. La conception d’un vaccin efficace met en jeux plusieurs paramètres qui sont décrits dans cet article, tels que le choix de l’antigène de tumeur, les plateformes d’administration du vaccin, le type de réponse immunitaire induit par les vaccins, avec un intérêt particulier pour les lymphocytes T CD4 et la diversification antigénique epitope spreading. Nous discuterons également de la place de la réponse lymphocytaire B dans les vaccins thérapeutiques. Les données prometteuses issues d’essais cliniques de vaccination en situation adjuvante dans les stades précoces sont abordées ainsi que l’importance de combiner les vaccins avec les immunothérapies anti-PD(L)-1 dans les stades avancés ou métastatiques.
Cas Clinique
- cancer du sein
- immunothérapie
- transplantation
- triple-négatif
Immunothérapie chez le greffé rénal : une approche personnalisée dans les cancers localisés
Baptiste MUSSO, Nolwenn ROBIN, Caroline BAILLEUX, Clément GOSSET, Ophélie CASSUTO
Résumé:
L’immunothérapie a transformé la prise en charge du cancer du sein triple négatif localisé, comme le démontre l’essai KEYNOTE-522. Ce protocole associant pembrolizumab, un anti-PD-1, et chimiothérapie en néoadjuvant, suivi de pembrolizumab en adjuvant pour un total d’un an, diminue de 35 % le risque de progression et de 5 % le risque de décès à 5 ans. Ce protocole est désormais recommandé …
L’immunothérapie a transformé la prise en charge du cancer du sein triple négatif localisé, comme le démontre l’essai KEYNOTE-522. Ce protocole associant pembrolizumab, un anti-PD-1, et chimiothérapie en néoadjuvant, suivi de pembrolizumab en adjuvant pour un total d’un an, diminue de 35 % le risque de progression et de 5 % le risque de décès à 5 ans. Ce protocole est désormais recommandé pour toute patiente présentant un cancer du sein triple négatif localisé de plus de 2 cm et/ou avec atteinte ganglionnaire. Cependant, chez les patients transplantés d’organe, l’utilisation des inhibiteurs de checkpoint expose à un risque élevé de rejet du greffon, avec un risque de perte définitive estimé entre 11 et 39 %. La décision d’introduire une immunothérapie dans ce contexte doit donc être soigneusement évaluée, en pesant le bénéfice oncologique contre le risque néphrologique. Nous rapportons le cas d’une patiente de 46 ans, greffée rénale pour néphropathie lupique, présentant une récidive d’un cancer du sein triple négatif localisé. Bien que l’indication théorique soit une chimio-immunothérapie néoadjuvante, une concertation pluridisciplinaire, prenant en compte l’avis de la patiente, a conduit à écarter le pembrolizumab au profit d’une chirurgie première suivie d’une chimiothérapie adjuvante. Ce cas illustre la complexité de la prise en charge des patients transplantés éligibles à l’immunothérapie. La balance bénéfice-risque doit être rigoureusement analysée, en associant étroitement le patient à la décision. En cas d’administration d’immunothérapie, un suivi néphrologique rapproché est indispensable, avec anticipation des mesures à prendre en cas de rejet. Une approche individualisée et pluridisciplinaire est indispensable pour optimiser la prise en charge de ces patients à haut risque.
Article Bref
Association immunothérapie et thérapies ciblées et adaptation des traitements chez le sujet âgé : et s’il devenait acteur ?
Johanne VANNEY, Fanny LEENHARDT
Résumé:
JUSTIFICATIF ET OBJECTIFS
Les sujets âgés représentent une proportion importante des patients atteints de cancer, avec une incidence en 2017 de 62,4 % chez les patients de 65 ans et plus (1). Cette prévalence conduit à la prescription fréquente d’association de traitement comme immunothérapies et thérapies ciblées chez cette population. Cependant, malgré une utilisation fréquente, les données disponibles …
JUSTIFICATIF ET OBJECTIFS
Les sujets âgés représentent une proportion importante des patients atteints de cancer, avec une incidence en 2017 de 62,4 % chez les patients de 65 ans et plus (1). Cette prévalence conduit à la prescription fréquente d’association de traitement comme immunothérapies et thérapies ciblées chez cette population. Cependant, malgré une utilisation fréquente, les données disponibles sur l’efficacité réelle et la tolérance de ces traitements chez les patients âgés sont limitées. Les études de phase III mettent en évidence une incidence variables d’effets indésirables entre les sujets âgés et plus jeunes pour les thérapies ciblées et immunothérapie, mais avec un gain clinique significatif pour l’ensemble des patients. Ces thérapies (orales et immunothérapies) ont un schéma posologique standardisé pour tous les patients, sans ajustement aux paramètres individuels tels que l’âge, la fonction rénale ou encore les comorbidités, pouvant influencer significativement la pharmacocinétique et la tolérance des thérapies ciblées orales.
Œil de l’interne
- CAR T cells
- cellules souches leucémiques
- immunothérapie
- LAM
- SLAMF6
Leucémie aiguë myéloïde et immunothérapies innovantes : CAR T-cells et anti-SLAMF6
Wala NAJAR, Vincent CAMUS
Résumé:
La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est une hémopathie clonale caractérisée par une accumulation de cellules progénitrices myéloïdes immatures, entraînant une suppression de l’hématopoïèse normale. Malgré des progrès thérapeutiques, le pronostic reste défavorable, en particulier chez les patients réfractaires ou en rechute. Face à ces limites, les immunothérapies …
La leucémie aiguë myéloïde (LAM) est une hémopathie clonale caractérisée par une accumulation de cellules progénitrices myéloïdes immatures, entraînant une suppression de l’hématopoïèse normale. Malgré des progrès thérapeutiques, le pronostic reste défavorable, en particulier chez les patients réfractaires ou en rechute. Face à ces limites, les immunothérapies représentent une nouvelle ère thérapeutique. Parmi elles, les cellules CAR-T ciblant des antigènes exprimés à la surface des cellules leucémiques, bien que révolutionnaires dans les hémopathies lymphoïdes, rencontrent des obstacles en milieu myéloïde, notamment l’hétérogénéité antigénique et la toxicité. Une cible prometteuse, SLAMF6 (Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family member 6), exprimée sur les cellules souches leucémiques, suscite un intérêt croissant. Des approches anti-SLAMF6, en monothérapie ou combinées, sont en développement préclinique. Cet article propose une synthèse des avancées de l’immunothérapie dans la LAM, principalement des CAR T-cells et des anticorps anti-SLAMF6, en discutant les défis et les perspectives de ces approches.
