Éditorial
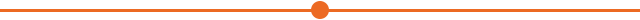
Chers collègues,
Je suis émue de vous annoncer, comme indiqué dans le courriel de Dimitri Verza, Directeur de la publication, Président d’Olimpe, que ce numéro est le dernier de LA REVUE Immunité & Cancer, « la première − et restée l’unique − revue francophone trimestrielle dédiée à l’immuno-oncologie ». Solidement ancrés dans l’immunooncologie, bénéficiant de l’expertise et de l’enthousiasme des membres du comité scientifique et du comité éditorial, notre but a été de fournir un éclairage scientifique sur les avancées de l’immuno-oncologie à travers des dossiers thématiques et des articles de mise au point, d’informer sur l’actualité dans les « articles brefs » et la rubrique « OEil de l’interne », et enfin d’échanger sur le concret de l’immuno-oncologie grâce aux cas cliniques.
Au cours de ces 9 années d’existence, nous avons fourni une information de qualité, couronnée par le Prix éditorial du Syndicat de la Presse et de l’Édition des Professions de Santé (SPEPS) pour trois de nos articles publiés en 2024 et 2025. Je remercie très sincèrement les nombreux rédacteurs d’avoir participé à cette aventure, portés par le sentiment d’être les acteurs du progrès de la médecine après des années de traversée du désert. Nous n’oublierons pas les moments intenses vécus lors des standing ovations des congrès de l’ASCO ou de l’ESMO ou de l’annonce de la remise du prix Nobel de médecine au Dr James Allison et au Professeur Tasuku Honjo pour « La découverte du traitement des cancers par inhibition de la régulation immunitaire négative ».
Grâce à vous, LA REVUE Immunité & Cancer a été un vecteur d’information et de réflexion sur les avancées thérapeutiques apportées par les inhibiteurs de checkpoint et leurs combinaisons, les « ADCs » (antibodydrug conjugates) et les CAR T-cells. D’autres innovations se préparent, qui vont encore prolonger les réponses cliniques du côté de la vaccination par mRNA, ou l’utilisation des cellules T modifiées et des anticorps, et le dark genome, un monde souterrain génétique qui commence à nous révéler ses secrets.
Un très grand merci à tous les auteurs qui ont soutenu bénévolement LA REVUE Immunité & Cancer, sans vous, sans votre enthousiasme, elle n’aurait pas existé. Je remercie aussi Déborah Sylvan, notre secrétaire de rédaction, pour son inlassable efficacité, son sérieux et sa gentillesse et Caroline Spasojevic pour son soutien et pour avoir toujours réussi à dénicher des auteurs lorsque nous étions à court d’idées !
Grâce au soutien sans faille de Dimitri Verza et de son équipe, LA REVUE Immunité & Cancer va continuer de vivre sous un nouveau format, intitulé « Les Cahiers de la Revue Immunité & Cancer », qui sera publié dans chaque numéro de la revue trimestrielle Tribune’K. Il prendra la forme d’un dossier thématique transversal, alternant entre tumeurs solides et hématologiques. Nous pourrons donc continuer à monter d’intéressants dossiers.
Au revoir donc compagnons de cette belle aventure, l’immunothérapie n’a pas dit son dernier mot !
Pr Catherine SAUTÈS-FRIDMAN
Rédactrice en chef de LA REVUE Immunité & Cancer
Rev Immun Cancer 2025 ; 9 (4) : 167.
