Recherche
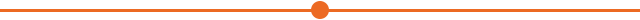
Editorial
Catherine SAUTÈS-FRIDMAN
Chers collègues,
Un nombre croissant de travaux s’intéressent aux biomarqueurs non invasifs de réponse à l’immunothérapie. Deux articles leur sont consacrés dans ce numéro de LA REVUE Immunité & Cancer, l’un portant sur la valeur prédictive de l’ADN tumoral (ADNct) circulant pour la réponse à la chimiothérapie plus immunothérapie dans les cancers œsogastriques …
Chers collègues,
Un nombre croissant de travaux s’intéressent aux biomarqueurs non invasifs de réponse à l’immunothérapie. Deux articles leur sont consacrés dans ce numéro de LA REVUE Immunité & Cancer, l’un portant sur la valeur prédictive de l’ADN tumoral (ADNct) circulant pour la réponse à la chimiothérapie plus immunothérapie dans les cancers œsogastriques (cf. Œil de l’interne ; Anis Alachkar, David Tougeron, Camille Evrard) et l’autre sur la valeur prédictive des taux d’IgG sériques anti-annexine A2 pour la réponse à anti-PD-(L)1 dans les cancers bronchiques (cf. Article bref ; Matthieu Roulleaux Dugage, François-Xavier Danlos, Nathalie Chaput, Aurélien Marabelle). Ce dernier article discute du lien a priori surprenant, entre les anticorps dirigés contre une molécule du soi comme l’annexine A2 et l’immunité antitumorale. Le cas clinique illustre l’intérêt croissant d’une approche personnalisée guidée par les biomarqueurs comme la claudine 18.2 dans le traitement des cancers gastriques et la place de l’immunothérapie dans ce contexte (Erwan Vo-Quang, Aziz Zaanan).
Mise au point
- cancer gynécologique
- immunothérapie
- inhibiteur de checkpoint
- vaccination thérapeutique.
L’immunothérapie en oncologie gynécologique
Laura MANSI, Lorraine DALENS, Clément DUBOURD, Guillaume MEYNARD
Résumé:
L’immunothérapie s’est positionnée comme une arme thérapeutique majeure dans le cancer de l’endomètre métastatique et dans le cancer du col de l’utérus métastatique et tout récemment également en situation adjuvante. Grâce aux résultats présentés à l’ESMO 2024 de l’étude KEYNOTE-A18, l’immunothérapie s’intègre en accès précoce dans le traitement du cancer du col localement avancé à haut risque. Malgré un rationnel scientifique solide, l’immunothérapie peine en revanche à trouver sa place dans la prise en charge du cancer de l’ovaire. Cependant, les études biologiques …
L’immunothérapie s’est positionnée comme une arme thérapeutique majeure dans le cancer de l’endomètre métastatique et dans le cancer du col de l’utérus métastatique et tout récemment également en situation adjuvante. Grâce aux résultats présentés à l’ESMO 2024 de l’étude KEYNOTE-A18, l’immunothérapie s’intègre en accès précoce dans le traitement du cancer du col localement avancé à haut risque. Malgré un rationnel scientifique solide, l’immunothérapie peine en revanche à trouver sa place dans la prise en charge du cancer de l’ovaire. Cependant, les études biologiques menées permettent d’identifier de nombreux marqueurs biologiques permettant de poursuivre la compréhension des mécanismes d’échappement tumoraux au système immunitaire. Ces résultats vont ainsi ouvrir à de nouvelles perspectives d’association afi n peut-être d’avoir recours à l’immunothérapie dans la prise en charge des cancers de l’ovaire. Nous ne pouvions pas parler d’immunothérapie dans les cancers gynécologiques sans évoquer le positionnement de l’immunothérapie dans la prise en charge des tumeurs trophoblastiques. Dans l’étude de phase I/II TROPHAMET, qui a fait l’objet d’une session plénière à l’ASCO, l’association avélumab au méthotrexate permet une normalisation du taux d’HCG chez plus de 95 % des patientes atteintes d’une tumeur trophoblastique à bas risque en traitement de première intention. Cet article est une mise à jour des différentes études d’immunothérapie dans les tumeurs gynécologiques, une mise en lumière des résultats qui ont permis de changer les pratiques et une synthèse des études à venir.
Cas Clinique
- cancer gastrique métastatique
- FOLFOX
- immunothérapie
- PD-L1
- TFOX.
- zolbétuximab
Cancer gastrique métastatique : vers une médecine de plus en plus personnalisée
Erwan VO-QUANG, Aziz ZAANAN
Résumé:
La prise en charge du cancer gastrique métastatique reste un défi thérapeutique, en raison d’un pronostic sombre (survie médiane < 12 mois) et d’une présentation souvent tardive de la maladie. L’arrivée de l’immunothérapie a récemment modifié la stratégie de première ligne pour les patients PD-L1 positifs et HER2 négatifs. Plusieurs essais de phase III ont montré un bénéfice de survie globale avec l’ajout d’un anti-PD-1 à la chimiothérapie dans cette population, notamment pour les patients avec CPS ou TAP positifs. La claudine 18.2 est surexprimée dans environ 35 à 40 % …
La prise en charge du cancer gastrique métastatique reste un défi thérapeutique, en raison d’un pronostic sombre (survie médiane < 12 mois) et d’une présentation souvent tardive de la maladie. L’arrivée de l’immunothérapie a récemment modifié la stratégie de première ligne pour les patients PD-L1 positifs et HER2 négatifs. Plusieurs essais de phase III ont montré un bénéfice de survie globale avec l’ajout d’un anti-PD-1 à la chimiothérapie dans cette population, notamment pour les patients avec CPS ou TAP positifs. La claudine 18.2 est surexprimée dans environ 35 à 40 % des adénocarcinomes gastriques. En 2023, deux essais de phase III ont démontré le bénéfice de l’ajout du zolbétuximab, un inhibiteur ciblant cette protéine, à une chimiothérapie standard en première ligne chez les patients HER2 négatifs surexprimant la claudine 18.2. Nous présentons ici le cas d’un patient atteint d’un adénocarcinome gastrique métastatique, PD-L1 fortement exprimé (CPS = 54), HER2 négatif, MSS, sans surexpression de la claudine 18.2, traité par FOLFOX et nivolumab. Ce cas illustre l’intérêt croissant d’une approche personnalisée guidée par les biomarqueurs, et la place désormais incontournable de l’immunothérapie dans l’algorithme de traitement des cancers gastriques. Si les bénéfices de l’immunothérapie en première ligne sont désormais bien établis chez les patients sélectionnés, son rôle en stratégie péri-opératoire ou en association avec la claudine_ 18.2 reste à définir. Des essais cliniques spécifiques seront nécessaires pour répondre à ces questions et affiner la médecine de précision dans le cancer gastrique.
Article Bref
Identification des auto-anticorps anti-annexine A2 comme marqueurs prédictifs d’efficacité de l’immunothérapie anti-PD-(L)1 dans les cancers bronchiques non à petites cellules
Matthieu ROULLEAUX DUGAGE, François-Xavier DANLOS, Nathalie CHAPUT, Aurélien MARABELLE
Résumé:
JUSTIFICATIF ET OBJECTIFS
Les anticorps bloquant PD-1 ou son ligand PD-L1 ont révolutionné le traitement de nombreux cancers, notamment du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC). Cependant, leur efficacité reste limitée à une proportion minoritaire de patients, soulignant la nécessité de biomarqueurs prédictifs performants. À ce jour, seule l’expression de PD-L1 est utilisée …
JUSTIFICATIF ET OBJECTIFS
Les anticorps bloquant PD-1 ou son ligand PD-L1 ont révolutionné le traitement de nombreux cancers, notamment du cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC). Cependant, leur efficacité reste limitée à une proportion minoritaire de patients, soulignant la nécessité de biomarqueurs prédictifs performants. À ce jour, seule l’expression de PD-L1 est utilisée en pratique clinique pour orienter le traitement vers un anti-PD-1 monothérapie ou en combinaison avec de la chimiothérapie (1,2). Des travaux récents ont mis en lumière le rôle des lymphocytes B et de la réponse humorale dans l’efficacité des inhibiteurs de points de contrôle immunitaire, notamment au travers des structures lymphoïdes tertiaires (3). Dans cette perspective, dans le cadre des études PREMIS et MSN, notre équipe a analysé les profils d’autoanticorps sériques de patients atteints de CBNPC par micro-arrays protéiques à haut débit, avant traitement par chimiothérapie, chimio-immunothérapie, ou anti-PD-(L)1 monothérapie. Les résultats ont mis en évidence une association forte entre la présence d’anticorps anti-annexine A2 (ANXA2) et la réponse à l’immunothérapie anti-PD-(L)1.
Article Bref
Toxicités à long terme de l’immunothérapie, que faut-il savoir ?
Charlée NARDIN, Elisa FUNCK-BRENTANO, Marie KROEMER, François AUBIN
Résumé:
JUSTIFICATIFS ET OBJECTIFS
L’immunothérapie par inhibiteurs de points de contrôle immunitaires aussi appelés inhibiteurs de « checkpoint » immunitaires (ICI) ciblant PD(L)1, CTLA-4 et LAG-3 (anti- PD(L)-1, anti-CTLA-4, anti-LAG-3), a transformé la prise en charge des cancers. De nombreux patients survivent à long terme. À titre d’exemple, 52 % de patients atteints de mélanome métastatique …
JUSTIFICATIFS ET OBJECTIFS
L’immunothérapie par inhibiteurs de points de contrôle immunitaires aussi appelés inhibiteurs de « checkpoint » immunitaires (ICI) ciblant PD(L)1, CTLA-4 et LAG-3 (anti- PD(L)-1, anti-CTLA-4, anti-LAG-3), a transformé la prise en charge des cancers. De nombreux patients survivent à long terme. À titre d’exemple, 52 % de patients atteints de mélanome métastatique traités par ipilimumab + nivolumab étaient vivants à 5 ans dans l’essai de phase III CheckMate 067 (1). Actuellement utilisés dans plus de cinquante indications distinctes, les ICI sont cependant associés à des effets indésirables immunomédiés (EI-im). Si les EI-im précoces sont bien décrits, les EI à long terme restent peu documentés. Avec l’extension des indications des ICI à des stades précoces (adjuvant et néoadjuvant) et dans de nombreux cancers, ces EI deviennent un enjeu de santé publique. Cet article vise à décrire les toxicités à long terme des ICI pour guider les praticiens dans leur détection, leur gestion, et l’évaluation du rapport bénéfice/risque de l’immunothérapie (2).
