Éditorial
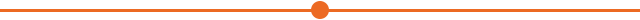
Cher(e)s collègues,
C’est avec un grand plaisir que je vous présente ce numéro post-8es Journées Scientifiques Immunité et Cancer (JSIC 2024). Véritable succès (1 200 participants), elles confirment l’immense intérêt des oncologues pour cette manifestation annuelle riche en informations couvrant les multiples aspects de l’immuno-oncologie, depuis les traitements jusqu’aux nouveautés de la recherche académique. La lecture de la mise au point (Boissel N, et al.) vous renseignera, spécialité par spécialité, sur les tops et les flops des résultats des essais thérapeutiques. Vous y lirez en particulier le succès des approches néoadjuvantes dans les tumeurs solides, des CAR T-cells et des anticorps bispécifi ques en oncohématologie. À propos des nouveautés en recherche académique présentées lors des JSIC 2024, vous pourrez retrouver dans le précédent numéro un article sur les « cellules de l’année », les cellules B, qui furent très longtemps négligées au profi t des lymphocytes T alors qu’elles produisent des anticorps, l’autre bras effecteur de l’immunité adaptative, à côté des cellules T cytotoxiques (Calvez A, et al., Rev Immun Cancer 2023 ; 7 : 164-74).
Les traitements par ICI s’accompagnent de toxicités variées liées à une levée de la tolérance au soi. Dans moins de 5 % des cas, elles atteignent les cellules du système nerveux, avec des présentations cliniques, des niveaux de sévérité et un pronostic extrêmement variables. Vous trouverez dans ce numéro un dossier thématique faisant le point sur les différentes formes de neurotoxicité associées aux ICI et sur leur prise en charge (cf. Dossier thématique ; Bastien Joubert). Les CAR T-cells sont elles aussi non dénuées de toxicité, induisant un « syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires » lié à la production de cytokines inflammatoires, comme observé lors du traitement des lymphomes B agressifs par les CAR T-cells anti-CD19. La mort des neurones provoque la libération de protéines des neurofilaments dans le sérum. L’oeil de l’interne présente deux études montrant que leur dosage sérique permet de prédire le risque de survenue de neurotoxicité, ouvrant une piste pour mettre en place un suivi des patients voire une prophylaxie associée au risque (cf. Œil de l’interne ; Marion Larue, Sophie Caillat-Zucman).
Les autres articles de ce numéro vous orienteront vers les cancers du sein, domaine où des progrès restent à réaliser. Cependant, les inhibiteurs de PARP et les anticorps couplés à un agent toxique commencent à prendre place en association avec l’immunothérapie (cas clinique et article bref), ainsi que les biomarqueurs de réponse (PD-L1, statut BRCA, HER2) dans les cas métastatiques. En oncohématologie, l’intérêt se tourne vers les CAR T-cells dans la leucémie myéloïde chronique après l’échec des anticorps monoclonaux ou des bispécifiques (cf. Article bref ; Thomas Cluzeau).
Très bonne lecture à tous et à très bientôt pour notre prochain numéro !
Pr Catherine SAUTÈS-FRIDMAN
Rédactrice en chef de LA REVUE Immunité & Cancer
Rev Immun Cancer 2024 ; 8 (1) : 3.
